Autour de la Place Pigalle
© A. Boutillon 2010 © 9e Histoire 2010 - 2014
AUTOUR DE LA PLACE PIGALLE,
AU TEMPS DE LA BOHÊME MONTMARTROISE
C'est dès la rue Saint-Lazare que le terrain commence à s’élever pour former la butte Montmartre. Jusqu’à la construction, entre 1784 et 1787, de l’enceinte des Fermiers généraux (1), toute la partie du neuvième arrondissement comprise entre l’ancien chemin des Porcherons et l’actuelle place Pigalle ne faisait qu’un avec le village de Montmartre, dont une grande partie était occupée par le domaine de l’abbaye des dames du même nom.
En 1787, à l’achèvement du « mur murant Paris », Montmartre se trouvera coupé en deux, sa partie basse alors rattachée à Paris.
La place Pigalle, formée dans le premier quart du XIXe siècle, s’appellera d’abord « place de la Barrière de Montmartre », du nom du bureau d’octroi qui s’élevait alors à cet emplacement. Ce n’est qu’en 1864 qu’elle recevra son nom actuel.
Entre temps, en 1860, grâce à l’annexion des communes limitrophes, Paris s’était agrandi, passant de douze à vingt arrondissements, et le bas Montmartre avait été intégré dans le neuvième. L’enceinte des Fermiers généraux avait été démolie, avec la quasi-totalité des pavillons de Ledoux. En 1863, l’architecte Gabriel Davioud élèvera, à l’emplacement de celui de la barrière de Montmartre, une fontaine, autour de laquelle se tiendra, jusqu’au début du XXe siècle, la Foire aux modèles, où les artistes venaient louer les jeunes femmes qui allaient poser pour leurs tableaux.
Au XVIIIe siècle, ces premiers contreforts de Montmartre avaient vu fleurir un très grand nombre de cabarets, terme qui, à l’époque désignait essentiellement les débits de boisson. En 1774, dans la seule rue de Rochechouart, encore fort peu peuplée, on en comptait dix-huit, dont certains portaient des noms assez évocateurs : La Fontaine d’Amour, Le Caprice des Dames, Le Berger Galant…, bien qu’on y trouvât aussi des enseignes dédiées au Père Eternel, à Sainte-Geneviève, ou encore aux Armes de Madame l’Abbesse. C’étaient souvent des lieux de débauche et de prostitution.
Les établissements qui verront le jour autour de la place Pigalle dans la seconde moitié du XIXe siècle, qu’ils s’appellent brasserie, café ou cabaret, seront mieux fréquentés. Leur clientèle, essentiellement masculine, sera surtout composée d’artistes, d’écrivains et de journalistes ; les femmes ne s’y aventuraient guère, sauf si elles étaient de mœurs légères ou si elles posaient pour les artistes, ce qui, souvent, revenait au même ; il y avait aussi, naturellement, les « professionnelles », qui traînaient là avec l’espoir de trouver un client…
On y discutait beaucoup, on y jouait aux cartes ou au billard et, bien sûr, on y buvait : la boisson préférée de la bohème montmartroise était alors l’absinthe, que ses adorateurs appelaient la fée verte (2).
La Brasserie des Martyrs et Le Cabaret de la Belle Poule
Deux établissements se faisaient concurrence, dans le bas de la rue des Martyrs : La Belle Poule et la Brasserie des Martyrs.
La Brasserie des Martyrs aurait été fondée dès 1848, par les frères Schoen.

Elle avait pour enseigne une peinture naïve où l’on voyait le légendaire roi Gambrinus se disposant à boire un énorme bock de bière mousseuse. Elle sera reprise peu après par un certain M. Bourgeois, qui en modifiera la décoration.
Installée sur trois niveaux, elle était, nous dit un chroniqueur anglais, meublée de divans élégants et de tables en chêne lustré, et ses lampes à gaz diffusaient une lumière éblouissante ; il note cependant que les dorures des miroirs et des moulures, ainsi que les fleurs artificielles et les cariatides, n’étaient pas de très bon goût. Il y avait une salle de billard, des cabinets particuliers et, au sous-sol, une taverne à la manière bavaroise, où la bière coulait à flots.
Ce sera, dans les années 1850, l’une des brasseries les plus populaires de Paris, qui aura parmi ses habitués les écrivains Henry Mürger, Alphonse Daudet, Jules Vallès, Charles Monselet, ou encore Baudelaire. Rendez-vous d’artistes, aussi : Gustave Courbet y discourait sur la peinture réaliste, entouré d’Alfred Stevens, Léon Bonnat ou Carolus-Duran, ainsi que de Champfleury et Castagnary, ses chantres fidèles; et puis quelques jeunes, comme Monet et Pissarro.
Entre 1890 et 1900 la Brasserie des Martyrs tentera, sans grand succès, de se muer en café concert ; en 1896, elle devient Le Bengali, puis La Savoyarde ; après un retour au nom d’origine, en 1897, avec la Brasserie Concert des Martyrs, elle fermera 1900.
Etabli presque en face, Le Cabaret de la Belle Poule ne fut d’abord qu’un modeste débit de boisson. Il avait pour enseigne un bateau, censé représenter celui qui, en 1840, avait ramené de Sainte-Hélène les cendres de Napoléon.
En 1862 il subira une rénovation complète, avec banquettes, glaces et dorures. Sa clientèle sera aussi composée de gens de lettres et d’artistes, souvent les mêmes qu’en face, mais on y verra également les parnassiens Catulle Mendès et Théodore de Banville, accompagnés de Poulet-Malassis, l’éditeur des Fleurs du Mal. Courbet, quant à lui, se partagera entre les deux établissements rivaux.
Des Incohérents aux Décadents
Au 16bis de la rue Fontaine s’était établi, en 1884, le Cabaret des Incohérents, où tout relevait d’une certaine bizarrerie : le soir, on projetait, sur les murs décorés par Grün, des ombres incohérentes et c’est là que Jules Lévy organisait ses expositions de peintures incohérentes. Il deviendra, en 1894, le café des Décadents, sous la direction artistique du sulfureux Jules Jouy (3), mais sera rapidement fermé, sur ordre de la Préfecture, en raison de l’indécence de ses spectacles.

Il rouvrira en 1895, dans un genre beaucoup plus sage, sous le nom de Café-concert des Décadents. Entre autres attractions, le programme présentait une chanteuse irlandaise, May Belfort, qui, soir après soir, habillée en bébé, un petit chat dans les bras, expliquait en anglais, avec une voix de petite fille, qu’elle aimait beaucoup son petit chat, mais qu’elle aurait préféré un toutou ; et, soir après soir, elle déchaînait l’enthousiasme du public (4).
Henri de Toulouse-Lautrec, venu dans ce nouveau Décadents pour voir Jane Avril qui, semble-t-il s’y produisait aussi, tombera immédiatement sous le charme de cette fausse ingénue, pour laquelle il réalisera plusieurs affiches.
Le Carillon
C’est aux Décadents que s’était fait connaître, sous le nom de Tiercy, le Lillois Georges Léon Stiers, un ancien étudiant en pharmacie reconverti dans la chanson, avant d’aller fonder son propre cabaret artistique, Le Carillon, au 43 de la rue de La Tour-d’Auvergne, au coin de la cité Milton (actuelle cité Charles-Godon). La salle de spectacle est installée au premier étage, tandis que le rez-de-chaussée est aménagé en café.
Tiercy, hélas, est mauvais gestionnaire et va conduire son établissement à la faillite, ce qui l’obligera à céder le Carillon à Bertrand Millanvoye, mieux connu sous le pseudonyme d’Alfred Bertrand.
Le Carillon possède un jardin, où se tiennent, les soirs d’étés, Les Assises du Carillon, tribunal humoristique où est jugée l’actualité du moment. La partie civile est représentée par la chanteuse Violette Dechaume, tandis que Millanvoye tient le rôle de l’avocat de la défense. Georges Courteline écrira pour ce théâtre plusieurs comédies en un acte : La Cinquantaine, Un Client sérieux, Une Lettre chargée…

Alfred Bertrand avait confié la direction du Carillon à Henri Dreyfus, encore peu connu, mais qui, sous le nom de Fursy, allait devenir une des plus célèbres figures du Montmartre des chansonniers (5).
Dreyfus avait commencé par travailler dans divers journaux, d’abord dans des emplois administratifs, puis comme rédacteur et reporter. Il commencera, en même temps, à écrire des chansons pour des vedettes du café concert, notamment Florence Duparc et Fragson, ainsi que des couplets satiriques inspirés par l’actualité, qu’il interprétera lui-même sur la scène du Carillon. Il appelait cela des « chansons rosses », et le public accourait de partout pour l’entendre dans son tour de chant.
Le Tréteau de Tabarin
En juillet 1895, Fursy quitte le Carillon pour aller ouvrir, avec deux associés, Georges Charton et Maurice Ropiquet, un cabaret qu’ils appelleront Le Tréteau de Tabarin.
L’établissement est installé dans l’ancien hôtel particulier de l’amiral Duperré, au 58 de la rue Pigalle. L’inauguration a lieu le 12 octobre.
Le cabaret, dont le décor affectait l’aspect d’une taverne ouvrant sur le pont Neuf, évocation du célèbre bateleur qui y dressait ses tréteaux au XVIIè siècle, était au rez-de-chaussée, tandis que le premier étage était occupé par le restaurant, puis cabaret, Lajunie.
Dès l’ouverture, le programme présente, aux côtés de Fursy, qui « désopilait toutes les rates avec ses chansons rosses » et Charton, qui « fragsonnisait joyeusement », un jeune Breton, Théodore Botrel, l’auteur à succès de La Paimpolaise, créée quelques mois plus tôt au Cabaret du Chien Noir (6), mais qui fait ici ses vrais débuts, avec « des couplets nostalgiques ou farouches » (7).
C’est Georges Dacquois, un jeune poète qui jouit déjà d’une certaine notoriété, qui l’a introduit auprès des patrons du Tréteau de Tabarin ; il y présente lui-même, en troisième partie du programme, une « parade étourdissante de verve et d’allure », intitulée Sur le Pont.
Le Tréteau de Tabarin connaît une telle célébrité qu’une riche Anglaise fera reconstituer à l’identique, pour une soirée, dans son jardin de Londres, la salle de la rue Pigalle.

La Grande Pinte
En 1878, le marchand de tableaux Laplace ouvre un établissement au 28 de l’avenue Trudaine, à l’angle de la rue Lallier. Il le baptise du nom d’un célèbre cabaret des Porcherons au XVIIIe siècle.
Pour se démarquer de ses concurrents, il donne à La Grande Pinte une décoration très originale, axée sur l’œuvre de Rabelais : un vitrail, en façade, raconte l’histoire de Panurge et de ses célèbres moutons, tandis que l’intérieur évoque une taverne médiévale. Il aura, dès le début, la clientèle des artistes et des littérateurs montmartrois.
L’Auberge du Clou
A côté, au numéro 30, s’installe L’Auberge du Clou, ouverte par un Suisse, Paul Tomaschet, associé à Mousseau, un ancien acteur. Le style est rustique, avec des fenêtres à petits carreaux garnies de rideaux de cotonnade rouge et des assiettes au mur. A l’étage, neuf grandes toiles d’Adolphe Willette ornent le restaurant : La Mariée, Le bon Aubergiste, Le Souper, Les Cerises, La Veuve de Pierrot, Le Punch, La Bière, L’Eau, et Le Vin.
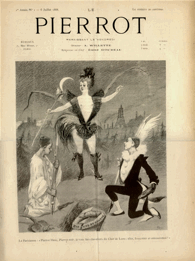
En 1888 aura lieu ici le baptême de la revue satirique Le Pierrot, publiée par Adolphe Willette (8) et Emile Goudeau. Entre 1888 et 1895, Courteline descendra tous les jours la rue Lepic pour venir boire son précipité à L’Auberge du Clou, où il corrige les articles qu’il destine à L’Echo de Paris ; c’est là aussi qu’il trouve ses « échantillons de la bêtise humaine » et qu’il met au point quelques canulars.
Erik Satie, qui s’asseoit souvent au piano, y rencontrera Suzanne Valadon, avec laquelle il aura une liaison de six mois.
Le Chat noir
En 1881, un personnage hors du commun avait fait une entrée tonitruante sur la scène montmartroise : Rodolphe Salis, né en 1851 à Châtellerault, où son père tenait un café.
Dès sa sortie du collège, le jeune homme trouve un emploi de représentant de commerce, où son bagout lui vaut une réussite totale. Mais Rodolphe a d’autres ambitions : il veut se lancer dans la carrière artistique et monte à Paris, où il devient illustrateur d’images pieuses pour les boutiques de Saint-Sulpice. Après quelques années de vaches maigres, le réalisme l’emporte : il décide de suivre les traces de son père et d’ouvrir un débit de boisson.
Il loue, au 84 du boulevard Rochechouart, dans le dix-huitième arrondissement, une boutique exiguë, qu’avec l’aide d’Adolphe Willette il réussit à transformer en taverne d’époque Louis XIII, et qu’il baptise Le Chat Noir. Au fond du local, un cagibi, pompeusement nommé l’Institut, accueille les habitués.
Salis va s’adjoindre de nombreux collaborateurs : Emile Goudeau et ses Hydropathes, auxquels s’ajouteront d’autres groupes de joyeux drilles, aux noms plus farfelus les uns que les autres : les Hirsutes, les Zutistes, les Incohérents, les Harengs saurs épileptiques ou encore les Phalanstériens de Montmartre (9).
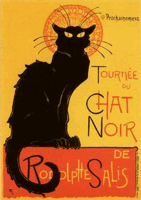
Aristide Bruant, dont les chansons sont déjà connues du tout Paris, est reçu à son tour au sein du cénacle ; c’est à cette occasion qu il compose sa fameuse ballade Le Chat Noir.
Les clients, qui sont introduits par un suisse en habit chamarré, adorent cette ambiance, même lorsqu’ils se font chahuter par le maître des lieux, dont la gouaille frise parfois le mauvais goût. Ici, il n’y a pas de jeu, il n’y a pas de femmes, mais le public, qui participe au spectacle, s’y amuse follement. Il n’est pas rare de voir un client s’asseoir au piano pour accompagner un chansonnier.
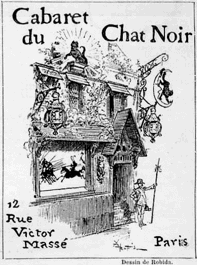
Le cabaret ne désemplit pas, et bientôt, malgré l’adjonction de la boutique contiguë, le besoin se fait sentir de locaux plus vastes. Salis jettera son dévolu sur un ancien hôtel particulier, au 12 de la rue de Laval, (10) construit en 1856 pour le peintre Victor Chavet, avec un jardin donnant sur la cité Malesherbes ; c’est un autre peintre, le Belge Alfred Stevens, qui l’avait occupé à partir de 1865.
Le 1er janvier 1885, la maison, qui s’étage sur trois niveaux, est louée à Rodolphe Salis, qui la fait réaménager par l’architecte Maurice Isabey, tandis qu’Henri Pille redessine sa façade pour lui donner l’aspect d’une hostellerie ancienne. Sur la baie centrale du deuxième étage, on installe l’enseigne : un énorme soleil doré, provenant d’une pagode de Ceylan, sur lequel est appliqué un grand chat en terre cuite. Deux lanternes sont suspendues à hauteur du premier étage. Une autre enseigne, dessinée par Adolphe Willette et représentant un chat se balançant sur un croissant de lune, est accrochée en épi près de la porte.
Le déménagement a lieu en grande pompe, musique en tête, dans la nuit du 10 juin 1885. Salis et ses collaborateurs traversent en procession, à la lumière des torches, le boulevard Rochechouart pour gagner la rue de Laval. Un gonfalonier portant fièrement l’étendard du Chat Noir ouvre la marche, suivi du garde suisse ; puis viennent le patron, en tenue de préfet de première classe, donnant le bras à sa femme, les garçons vêtus en académiciens, les uns portant religieusement le Parce Domine , l’immense toile de Willette (11), et les autres traînant une charrette à bras dans laquelle est entassé pêle-mêle tout le bric-à-brac de Salis, tandis que la cohorte des artistes, poètes et chansonniers ferme le cortège en chantant à tue-tête l’hymne de Bruant : « Je cherche fortune / Autour du Chat Noir / Au clair de la lune / A Montmartre, le soir ».
Dans la salle du rez-de-chaussée, aménagée en café musical, est installé un vitrail dessiné par Willette et intitulé Te Deum laudamus, ou Le Veau d’or (12). Au premier étage, dans la salle du conseil, où se réunit le comité de rédaction de la revue Le Chat Noir (13), se produisent les artistes, poètes et chansonniers.

Au deuxième et dernier étage, dans l’ancien atelier des peintres, a été accroché le Parce Domine ; c’est là aussi que sera créé le Théâtre d’ombres d’Henri Rivière et Caran d’Ache, qui vaudra au cabaret de Salis une renommée internationale, et qui sera souvent copié par ses concurrents : c’est ainsi que Paul Tomaschet aménagera le sous-sol de l’Auberge du Clou afin d’y installer à son tour un théâtre d’ombres, où seront créées deux productions, sur des décors du peintre espagnol Miguel Utrillo, le père putatif de Maurice, et une musique d’Erik Satie.
Après la mort de Rodolphe Salis, en 1897, Le Chat Noir fermera et son contenu sera vendu aux enchères à Drouot en mai 1898 (14).
L’Ane Rouge
Rodolphe Salis avait fait venir à Paris son jeune frère, Gabriel, pour l’aider dans la gestion du Chat Noir. Mais la personnalité de Rodolphe va amener les deux frères à se brouiller, et Gabriel ira fonder son propre cabaret, rue Trudaine, dans les locaux laissés vacants par La Grande Pinte. Il baptise son établissement L’Ane Rouge, allusion non déguisée à son frère, que la nature a doté d’une magnifique toison rousse. Il emmène avec lui beaucoup des clients et des collaborateurs du Chat Noir, lassés par les façons désinvoltes et la radinerie du patron.

Gabriel Salis cédera son cabaret en 1898 au fantaisiste Andhré Joyeux ; mauvais gestionnaire, acculé à la faillite, celui-ci se suicidera un an plus tard.
Différents propriétaires se succéderont au long du vingtième siècle. Les locaux sont aujourd’hui occupés par le restaurant Le Paprika.
La Boîte à Fursy
Nous avons laissé Fursy dans son Tréteau de Tabarin, qui connaît un formidable succès. En novembre 1899, cependant, il se brouille avec son associé et se retire du Tréteau, pour signer aussitôt le bail de reprise du Chat Noir, dont les locaux, rue Victor-Massé, étaient restés libres depuis la mort de Salis.
La grande salle est transformée en place de village et le nouveau cabaret est inauguré le 22 décembre, sous le nom de La Boîte à Fursy. Le spectacle d’ouverture présente une opérette en trois actes, Robinson n’a pas cru Zoé, avec Théodore Botrel et Odette Dulac.

En partant, Fursy n’a pas seulement emmené Botrel, mais aussi une bonne partie de la clientèle. Dès lors, Le Tréteau de Tabarin ne cessera de péricliter et finira par fermer. Le restaurateur Lajunie, installé au-dessus, qui s’était constamment agrandi entre temps, récupérera le bail et convaincra Fursy de réintégrer ses anciens locaux.
Ces va-et-vient n’ont pas été préjudiciables au cabaret, où le public est de plus en plus nombreux : le Tout-Paris s’y presse pour entendre les chansonniers brocarder les hommes politiques, et il n’est pas rare d’y voir des têtes couronnées de plusieurs pays d’Europe.
En 1909, Fursy achètera La Scala, un ancien café concert qui avait connu son heure de gloire, dans l’idée d’y monter des opérettes à grand spectacle. Mais le résultat ne sera pas à la hauteur de ses espérances et il revendra l’établissement cinq ans plus tard, pour ne plus s’occuper que de sa boîte, qui, entre temps, était devenue Fursy et Mauricet (15).
On a pu voir aussi, rue Pigalle, au numéro 73, Le Casino des Concierges, cabaret ouvert en 1893 par Maxime Lisbonne, ancien colonel sous la Commune, ce qui lui avait valu d’être déporté en Nouvelle-Calédonie (16).

Le Rat Mort
Il y avait, sur la place Pigalle, au numéro 7, un débit de boisson qui s’honorait du nom de Grand Café de la place Pigalle. Ses débuts avaient été plutôt modestes, mais il allait bientôt connaître la gloire. Un jour, en effet, on décida de le rénover ; dès sa réouverture, sans attendre que les plâtres aient complètement séché, les clients vont commencer à s’y attabler. Mais les murs exhalent l’odeur du plâtre humide, et quelqu’un s’exclame : « Mais ça sent le rat mort, ici ! ». Une autre version veut qu’il y ait eu effectivement un rat mort, que l’on aurait retrouvé sous une banquette ou, selon les sources, dans la pompe à bière! Toujours est-il que les habitués rebaptiseront l’établissement Le Rat Mort, nom qui deviendra bientôt officiel.
Le Grand Café de la Place Pigalle avait ainsi trouvé sa nouvelle enseigne, tout à fait conforme à l’esprit du temps. Le plafond du café s’ornera bientôt d’une peinture, d’un goût plutôt douteux, où Goupil a représenté un énorme rat crevé. Faverot, quelques années plus tard, décorera les murs de panneaux représentant quatre moments de la vie du rat : Le Baptême, La Noce, L’Orgie et La Mort.
Dans les années 1880, on y verra, le vendredi, les collaborateurs du Courrier français, autour de Raoul Ponchon, qui tient dans ce journal une chronique en vers hebdomadaire.
Le Rat Mort connaîtra une renommée internationale, qui atteindra son apogée lors de l’exposition universelle de 1900. C’est sans doute pour plaire aux visiteurs anglo-saxons que l’on verra fleurir, sur la façade de l’immeuble, l’enseigne The Dead Rat.
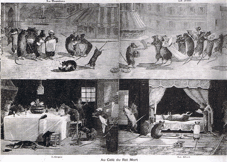
La Nouvelle Athènes
Il suffisait de traverser la rue Frochot pour trouver, toujours sur la place Pigalle, au numéro 9, un autre établissement qui, lui aussi après des débuts modestes, allait devenir un des cabarets de Montmartre les plus courus de la fin du second Empire.
Ce café, qui avait pris pour enseigne le nom du célèbre quartier voisin, sera, au milieu des années 1870, le rendez-vous des peintres dits « intransigeants », que l’on appellera plus tard les Impressionnistes.

Au cours de la décennie précédente, ces artistes avaient pris l’habitude de se réunir au Café Guerbois, au numéro 9 de ce qui s’appelait encore la Grande Rue des Batignolles, et qui allait devenir l’avenue de Clichy. C’est Edouard Manet, dont le domicile et l’atelier se trouvaient alors aux Batignolles, qui avait fait découvrir l’établissement à ses amis. Manet, qui avait osé défier les puissances artistiques établies, s’était trouvé promu, par ses jeunes admirateurs, chef de l’Ecole des Batignolles, nom que s’était donné le groupe du café Guerbois, et qui réunissait, outre Edgar Degas, Zacharie Astruc et Emile Zola, ses amis intimes, Fantin-Latour, Alfred Stevens, Constantin Guys, Félix Tournachon (mieux connu sous le nom de Nadar), ainsi que quelques peintres novateurs : Monet, Cézanne, Renoir, Bazille et le tout jeune Jean-Louis Forain.
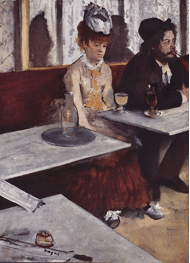
La guerre franco-prussienne et la Commune mettront un terme à ces réunions, où s’affrontaient souvent les tempéraments au cours de discussions enfiévrées, et le groupe se dispersera. Après la tourmente, il se reformera en partie au café de La Nouvelle Athènes, mais l’équipe du Café Guerbois s’est réduite : Bazille a été tué au combat, en 1870, Monet et Cézanne sont le plus souvent dans leur campagne et Renoir, bien que son atelier se trouve à deux pas de là, ne fait que de rares apparitions.
D’autres écrivains rejoindront le groupe : Stéphane Mallarmé, Villiers de l’Isle-Adam, Catulle Mendès et Jean Richepin.
Avec ses grandes glaces et ses banquettes de moleskine, La Nouvelle Athènes a servi de cadre à Manet, en 1878, pour son tableau « La Prune », dont le modèle est l’actrice Ellen Andrée (17). C’est elle aussi qui avait posé en 1876 pour « L’Absinthe » de Degas, dans ce même café, aux côtés du graveur Marcellin Desboutin.
En 1885, c’est Suzanne Valadon qui servira de modèle à Federico Zandomeneghi, peintre macchiaiolo arrivé à Paris de son Italie natale en 1874, pour son tableau « Il Café de la Nouvelle Athènes »
La Nouvelle Athènes deviendra, au début du vingtième siècle, un café concert, sous la direction de la chanteuse Eugénie Buffet ; il sera ensuite transformé en restaurant, le Monico, puis New Monico après la guerre de 14-18.
L’Abbaye de Thélème
Le 22 mai 1886, au numéro 1 de cette même place Pigalle, s’ouvre un nouveau « cabaret à décor », L’Abbaye de Thélème, dans la veine de La Grande Pinte et du Chat Noir. Il était annoncé depuis plusieurs mois dans Le Courrier français, de sorte que le public attendait avec impatience son inauguration (18).
A l’extérieur, la façade n’annonce pas vraiment la couleur, mais une fois le porche d’entrée franchi on se trouve dans un vestibule où se mêlent, en une joyeuse fantaisie, le style pompéien et le Moyen Age. Après un second vestibule, où l’on est accueilli par des gargouilles à tête de cochon de lait, on traverse une série de salles au décor délirant, entre gothique et renaissance ; pour l’une d’elles, l’illustrateur Henri Pille a dessiné deux panneaux : L’Abbaye de Thélème et La Bataille de Picrochole. C’est encore à lui que l’on doit, au premier étage, le dessin des trois vitraux : L’Amour, François Ier badinant avec les demoiselles et Le Repas pantagruélique, qui ferment les grandes baies d’une vaste salle où les artistes qui fréquentent les lieux présentent leurs œuvres. Au dernier étage ont été aménagés des cabinets particuliers.
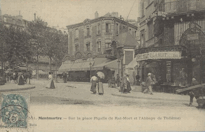
Le mobilier est dans la note, avec ses buffets de style gothique flamboyant. Et, pour compléter le tableau, les serveurs, dans cette abbaye d’un nouveau genre, sont habillés en moines et les serveuses en moniales.
Cet établissement fastueux, qui deviendra un luxueux restaurant, possède un jardin avec une tonnelle pour l’été, où le repas est agrémenté par le bruit d’une cascade artificielle.
Que reste-t-il de tout cela ?
Quelques uns de ces établissements ont encore connu, au vingtième siècle, des heures glorieuses, souvent sous d’autres noms, puis ils fermeront aussi et les maisons qui les avaient hébergés seront presque toutes démolies.
Mais c’est dès le début du siècle que le Pigalle de la bohème montmartroise a commencé à changer : avec le développement du tourisme, les anciens cabarets d’artistes se sont transformés en night-clubs ou en boîtes à strip-tease.
Le cabaret de Fursy a disparu, remplacé par un grand immeuble. Sur la place Pigalle, les guirlandes de L’Abbaye de Thélème sont depuis longtemps éteintes et Le Rat Mort, est devenu la boîte de nuit Le Cupidon. Quant à l’immeuble où se trouvait La Nouvelle Athènes, il a été récemment remplacé par un bâtiment neuf.
L’Auberge du Clou fait figure de rescapée, ayant traversé les décennies sans trop de dommages, même si les toiles de Willette n’y sont plus et que les chansonniers l’ont désertée. A côté, on peut encore rêver à L’Âne Rouge en dégustant un repas hongrois au Paprika.

Notes
(1) Afin d’empêcher les Parisiens de frauder l’octroi sur les marchandises entrant dans Paris, les fermiers généraux obtinrent de Louis XVI l’autorisation d’élever une enceinte fiscale autour de la capitale. Claude-Nicolas Ledoux, chargé de sa construction, réalisa la majeure partie des Propylées où étaient installés les bureaux de l’octroi. Cette clôture constitua, pour les Parisiens, un grief de plus contre le régime et fut sans doute une des causes de la Révolution.
En 1791, l’Assemblée constituante abolit les droits d’octroi, mais cette décision se révéla catastrophique pour les municipalités ainsi privées de leur principale ressource fiscale. Le 18 octobre 1798, le Directoire rétablit l’octroi à Paris, et celui-ci allait continuer à être perçu pendant près de 150 ans, car il engendrait environ 60% des revenus de la municipalité. En 1897, les viticulteurs obtiendront que les droits sur le vin, considéré « boisson hygiénique », soient abaissés. Il faudra attendre l’occupation allemande et les difficultés d’approvisionnement pour que, en 1943, l’octroi soit enfin aboli ; néanmoins, la mesure ne sera légalisée qu’à partir du 1er janvier 1949.
(2) L’absinthe a d’abord été utilisée pour ses vertus médicinales, notamment lors de la conquête de l’Algérie, en 1830, pour combattre la dysenterie ; les soldats du Bataillon d’Afrique, qui y avaient pris goût, la firent connaître quand ils rentrèrent en France, et elle devint populaire dans tous les cafés. En 1875, les ligues antialcooliques, soutenues par les syndicats, l’Eglise, les médecins et l’ensemble de la presse, vont tenter de l’interdire, en faisant valoir que « l’absinthe rend fou, elle fait de l’homme une bête féroce, elle désorganise la famille et ainsi l’avenir du pays ». Mais ce sera sans succès, car elle deviendra de plus en plus populaire et connaîtra son apogée entre 1880 et 1910, avant d’être finalement interdite en 1915.
(3) Ancien garçon boucher, devenu auteur de chansons et journaliste, il sera aussi chansonnier, faisant ses débuts au Chat Noir dès son ouverture, en 1881. En 1882, il fonde le Journal des Merdeux, dont les textes et les dessins ne traitent que de sujets scatologiques ; la publication sera aussitôt interdite, au motif de son « caractère pornographique ». A partir de 1894, il manifeste de sérieux troubles mentaux, dus sans doute à une consommation excessive d’absinthe, et meurt fou en 1897, âgé de 42 ans. Le Café des Décadents a été repris en 1896 par la chanteuse Marguerite Duclerc.
(4) « I’ve got a little cat, I’m very fond of that, but I’d rather have a bow wow »: refrain de la chanson écrite par l’Anglais Joseph Tabrar, en 1892: « Daddy wouldn’t buy me a bow wow ».
(5) Il avait commencé par transformer son patronyme en de Fursy, anagramme parfaite de Dreyfus, mais il avait rapidement laissé tomber la particule.
(6) Jules Jouy s’était brouillé avec Salis et était allé fonder, rue Saint-Honoré avec Vincent Hyspa, Paul Delmet et Victor Musy, autres déçus du patron du Chat Noir, un cabaret qu’ils avaient baptisé, par dérision, Le Chien Noir. C’est là que viendront les rejoindre Emile Goudeau, Alphonse Allais et un petit débutant venu de Bretagne, Théodore Botrel.
(7) Harry Fragson, nom de scène de Léon Pot (1869-1913), est né à Londres d’un père français et d’une mère belge. Il s’accompagnait lui-même au piano et s’était rendu célèbre par ses mimiques. Outre son pseudonyme à consonance anglaise, il avait adopté un léger accent d’Outre-Manche. Les parties de phrase entre guillemets sont extraites des « Souvenirs » de Théodore Botrel.
(8) Adolphe Willette, peintre, illustrateur et caricaturiste, s’était présenté aux élections de 1888 comme candidat antisémite. En 2004, le square qui portait son nom, à Montmartre, a été débaptisé pour être remplacé par celui de Louise Michel.
(9) Ces petits groupes d’artistes, de chansonniers et de poètes ont formé le courant qu’on appellera « la bohème » ; ils existaient avant la création du Chat Noir, mais ils furent canalisés naturellement vers ce cabaret, qui sortait des sentiers battus. Jules Lévy, fondateur des arts incohérents, avait fait partie du cercle des Hydropathes.
(10) Elle deviendra rue Victor-Massé en 1887. Aristide Bruant avait depuis longtemps envie de quitter Salis, qui, d’une pingrerie notoire, ne le payait pas pour ses prestations. Il profitera de ce déménagement pour fonder, dans les locaux libérés par son ancien patron, son propre cabaret, Le Mirliton.
(11) On peut la voir au musée de Montmartre.
(12) Il est conservé au musée Carnavalet, dans les salles consacrées à la Belle Epoque.
(13) Salis a eu l’idée géniale de créer, à partir de janvier 1882, un hebdomadaire de quatre pages, qui porte le nom du cabaret, et dont tous les collaborateurs sont bénévoles. Il est tiré à mille exemplaires et distribué gratuitement dans les kiosques.
(14) Dix ans plus tard, un certain Jean Chargot entreprit de ressusciter le cabaret de Salis au 68, boulevard de Clichy, sous le nom de Caveau du Chat Noir, derrière une façade à pans de bois, pour rester dans l’esprit que Salis avait voulu imprimer au sien.
(15) Mauricet était lui aussi chansonnier. Fursy et Mauricet est parfois mentionné comme Le Moulin de la Chanson.
(16) A son retour en France, il avait fondé La Taverne du Bagne, à l’angle du boulevard de Clichy et de la rue des Martyrs, côté dix-huitième, où les serveurs étaient habillés en forçats ; par la suite, il avait créé, au 54, boulevard de Clichy, Les Frites révolutionnaires, où le service était assuré cette fois par Louis-Philippe, Napoléon III ou Boulanger.
(17) Ellen Andrée (1857-1925) a joué dans près de trente pièces de théâtre, notamment des œuvres de Courteline, Jules Renard et Sacha Guitry. Elle a aussi posé plusieurs fois pour des peintres ; on la reconnaît, entre autres, dans « Le Déjeuner des Canotiers », de Renoir.
(18) L’immeuble avait été construit pour Narcisse Diaz de La Peña (1807-1876), peintre paysagiste de l’école de Barbizon. D’autres artistes y auront aussi leur atelier : Eugène Fromentin (1820-1876) , Ferdinand Roybet (1840-1920), ainsi que l’affichiste Frédéric Hugo d’Alesi (1849-1906) ; ce dernier avait inventé un « Maréorama », qu’il avait présenté à l’exposition universelle de 1900 : c’était un panorama donnant l’illusion complète d’un voyage maritime, avec roulis et tangage.
Principales sources :
Raphaël Gérard : « Paris et ses Cafés. Montmartre ». Action Artistique de la Ville de Paris .
Thierry Cazaux : « Paris et ses Cafés. Fursy, cabaretier de la Butte ». Action Artistique de la Ville de Paris .
Thierry Cazaux : « La Nouvelle Athènes. Le Cabaret du Chat Noir ». Action Artistique de la Ville de Paris..
« Manet et son Temps ». Le Monde des Arts. Time-Life Alfred Fierro : “Histoire et Dictionnaire de Paris”. Robert Laffont. / Jacques Hillairet : « Dictionnaire historique des rues de Paris ». Editions de Minuit.
Sur Internet: Impressionism. Early History. / Food in the Arts. Café Society. /
Bernard Vassor: “Sur les pas des écrivains” et “Autour du Père Tanguy”. / « Autour du Chat Noir ». Théâtre Populaire de Châtellerault
Aline BOUTILLON
© A. Boutillon 2010 © 9e Histoire 2010 - 2014
Catégorie : - Rues & Promenades
Page lue 15215 fois


